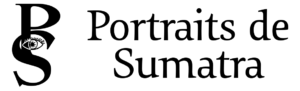Hasballah
Hasballah est le coordinateur de l’équipe de terrain du CRU (Conservation Response Unit, voir le projet) de Mane. Je l’ai vu quelques fois au bureau mais j’ai eu la chance de vraiment le connaitre lorsque je suis allée pour la première fois sur le terrain avec lui, visiter le camp de Mane. C’est là que j’ai compris que sa place est sur le terrain, plus que dans un bureau. Mane est un district géographiquement très reculé et à un lourd passé historique puisqu’il se situe dans l’une des régions les plus touchés par la guerre civile d’Aceh qui s’est terminée il y a moins de dix ans. Hasballlah a su créer, dans ce contexte, une relation de proximité avec la population locale et l’équipe de terrain.
Comme pour la plupart de mes portraits, je lui ai demandé son sentiment à l’égard de l’éléphant, l’animal. Il a eu cette réponse en deux points, « l’éléphant est un énorme animal. C’est un animal qui fait peur ». Cependant, il a de suite pondéré ces paroles en ajoutant que cependant si on prête attention à leur comportement et à leurs caractères, « car chaque animal a un caractère bien défini », on tombe amoureux de cette espèce avec qui on peut construire une « réelle relation d’amitié ».
Hasballah a suivi des études de gestion forestière et a commencé à s’impliquer dès ses études dans une organisation étudiante reliée aux activités relatives à la nature. Il a ensuite trouvé son premier travail avec BPN, l’institution en charge de la gestion des terres en Indonésie, mais c’était un travail trop bureaucratique selon lui et il avait besoin « d’action concrètes ». Il est donc revenu à Aceh en 1998, où il a travaillé une année au sein de CARITAS et a mis en place un programme de sensibilisation de la population locale sur l’impact négatif de la méthode de défrichement des terres par le feu. Il a ensuite rejoint l’équipe de Flora and Fauna International (FFI) en 1999 où il a d’abord été coordinateur de terrain pour ensuite s’occuper uniquement de la coordination du camp de Mane dès sa création en 2009. On ressent d’ailleurs en parlant avec lui l’attachement attendrissant qu’il porte au CRU. Pour le camp, il est en charge de la collaboration entre les différents acteurs impliqués : la population, le gouvernement local, l’équipe de terrain, le bureau principal de FFI etc…
Le conflit entre l’homme et l’éléphant, il ne le décrit par comme un conflit entre l’humain et une espèce, mais entre une population locale et un individu d’une population d’éléphants. Le conflit a commencé quand les destructions de champs cultivés par les éléphants ont augmentées et il « comprend la détresse des habitants locaux face à ces attaques ». Au départ, selon Hasballah, c’était simple, les éléphants avaient un territoire où ils pouvaient trouver leur nourriture. Il m’explique que les éléphants suivent souvent les mêmes voies et reviennent sur les sites où ils savent qu’ils peuvent trouver la nourriture. Cependant, les populations locales ont étendu leurs cultures « et maintenant cela n’appartient plus aux éléphants et leur territoire est réduit. Les villageois voient les éléphants comme une espèce qui vit sur leurs propriétés alors qu’en fait ce sont eux qui sont entrés sur son territoire ». Au début, sa mission principale au sein du CRU était donc d’éduquer la population par rapport au conflit avec les éléphants : « j’expliquais pourquoi les conflits survenaient mais aussi, car c’était nécessaire, les bases de la conservation de l’environnement ». Puis il a enseigné les compétences nécessaires pour répondre au conflit avec les éléphants.
Pour Hasballah, la qualité principale des CRUs est d’éviter que le conflit s’amplifie. Les CRUs sont là pour intervenir en cas de conflits et « créent un rapport gagnant-gagnant pour les éléphants et la communauté ». Sans les CRUs, tout cela ne serait pas possible. Cependant la mission première des CRU est l’éducation de la population locale sur les principes de la conservation de l’environnement et Hasballah a le sentiment qu’ils n’ont pas encore atteint leur objectif. Il espère un jour pouvoir créer un mouvement de réactions en chaine où les groupes sensibilisés à la protection de l’environnement transmettraient leurs connaissances aux groupes suivants, et ainsi de suite. Si on obtient ce résultat, « le conflit sera traité comme il faut ».